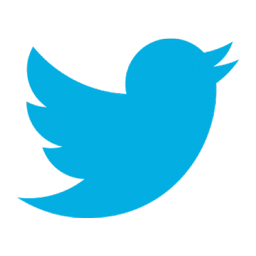Salagir fiction - Si ces murs pouvaient parler

Si ces murs pouvaient parler
Cette histoire est si vieille qu'elle se passe à une époque sans valises à roulettes.
Vous vous demandez peut-être comment nous survivions sans téléphones portables, sans internet, et parfois je me le demande aussi, oublieuse de ma propre jeunesse. Mais on oublie tous bien d’autres avancées technologiques pourtant très pertinentes, comme la valise à roulettes.
J'avais sur moi une énorme valise des temps anciens, faux cuir marron, aux angles bien droits, chacuns renforcés d'un coin en métal. Avec une unique poignée au milieu. Une fois posée à terre, je n'avais pas besoin de me baisser pour l'attraper. Ce qui m'obligeait à me pencher du côté opposé pour la soulever. Pour m'y aider, je tenais de l'autre main un sac, plus petit que la valise (un sac dépassant la taille de cette valise ne pouvait exister) mais qui compensait par sa largeur. En toile noire, il avait pris la forme de son contenu, des excroissances le déformaient en son centre et sur les deux côtés, raclant les flancs de son porteur, ou plutôt de sa porteuse, puisque c'était moi. Le sac était de loin plus lourd que la valise. On ne l'aurait pas deviné à première vue, malgré son ventre bedonnant. Mais si la valise était classiquement remplie de vêtements et petites affaires de voyage, le contenu du sac était bien plus dense. Il était chargé de papiers, de tous les documents dont je pensais avoir besoin, ou plutôt dont je m'étais armée dans le doute. Quand on ne sait pas ce qu'il faut apporter, on prend tout. Et dans ma longue vie, j'avais accumulé beaucoup de « tout ». C’est ça la puissance de l'administration française et de sa paperasse. En cette période qui se situe entre les dinosaures et votre lecture, il n'y avait pas de clef USB non plus.
Il va sans dire que je ne pouvais pas avancer plus de dix mètres sans faire une pause en haletant. Le voyage était donc difficile. À Lyon, c'est mon fils qui m'avait conduite à la gare et avait porté les deux bagages jusque dans le TGV. Ce n'est pas mon fils, c'est le mari de ma fille. Mais je trouve le terme beau-fils terriblement laid. Nous avions une discussion silencieuse pendant le trajet. Pendant que nous étions arrêtés aux feux rouges, il portait sur moi de brefs regards implorants.
— Mais que vas-tu donc faire dans cette galère, mamie...? Pensait-il sûrement.
Il ne l'avait pas exprimé tout haut, parce que ça ne servait à rien. Mon obstination est connue dans la famille, et puis, on en avait discuté de nombreuses fois, déjà.
— Je vais faire ce qui compte vraiment. Répondis-je dans ma tête.
Parce que votre boulot, vos réunions, la ceinture du petit au judo, la rage de dents de la dernière, tout cela ne compte pas. C'est du quotidien, c'est temporaire. L'héritage et l'histoire de la famille, c'est ça qui compte.
— Et je vais le faire seule parce que vous avez perdu de vue ce qui compte vraiment. Continuais-je dans ma tête.
Le père travaille. La mère travaille. Quand vont-ils pouvoir aller dans un bled perdu à sept heures de voiture ou de train ? Les week-ends sont trop courts, et le petit a judo. Ils n'ont presque pas de vacances. Et les prochaines sont déjà prévues et réservées. Mais qu'allez-vous faire sur cette plage surchargée, où vous n'avez aucun passé, aucune attache ? Juste des vendeurs criards et des mégots dans le sable.
Cette grande maison à la campagne, c'est la vôtre. C'est celle de vos ancêtres. On y trouve le calme, c'est joli, et c'est moins cher que de payer un hôtel avec vue sur la rue passante. Le petit déjeuner sur la terrasse de la maison sous la tonnelle de roses, sous le chant des oiseaux, c'est quand même mieux que le chouchou hyper calorique, le cul dans le sable après dix minutes de marche entre les voitures. Oui, il faut s'en occuper des roses, mais le jardinage c'est aussi plus intéressant que le bronzage... moins de cancer, et plus d'apprentissage.
Aaaaah, bien sûr, il n'y a pas la télé. Mais pour moi, c'est l'argument principal !
Mon autre fiston a été plus direct. Vends tout, c'est une ruine. Si j'y reviens, c'est pour foutre le feu et toucher l'assurance.
Il omettait sciemment que si c'était une ruine, ça ne se vendrait pas très cher, et qu'il serait malvenu d'incendier une baraque habitée.
Mais je comprenais sa rancœur par rapport à ce petit manoir. Les occupants actuels avaient été infects avec nous. Il y a vingt ans, quand on avait échangé les clefs, il avait eu une violente altercation avec l'un d'eux. Des menaces d'avocat et du mépris avaient ponctué leurs phrases.
Voilà ce que je partais faire. Je partais récupérer les clefs de l'ancienne demeure familiale, et nos droits y afférent.
C'étaient des amis de la famille. Également de lointains cousins. Leurs parents et mes parents étaient copains comme cochons. Nous, les enfants, nous nous croisions parfois pendant les vacances. Puis nous avons grandi et fait des enfants et il n'était plus possible de venir en même temps. La tension montait, il commençait à y avoir des altercations. Il y avait eu des travaux, et tout le monde avait participé au financement. Mais à des degrés divers, inégaux. Les « cousins », en moyenne, étaient plus riches et avaient participé davantage. Et des années plus tard, alors que mes parents et leurs parents, le ciment de l'entente, sont morts, à qui appartient la maison ?
Avec l'aide d'avocats et en relisant plusieurs fois le testament de mon père, voici le contrat final qui avait été conclu : la famille des cousins, et dans les faits, Georges Lefontaigner, avaient l'usufruit de la propriété pendant vingt ans. Suite à quoi, notre famille, en l'occurrence moi, la récupérait. Moi, parce que mon frère et ma sœur sont morts, et que leurs enfants avaient lâché l'affaire depuis longtemps.
Ils m'avaient signé les papiers qui attestaient de cet état de fait : une dizaine de pages par personne, qui, en langage juridique signifiaient ceci : Je laisse la maison à Janine Bronsard. Les avocats ont besoin de plus de mots que le sens commun. Ces papiers ajoutaient un peu de poids dans mon sac.
J'avais donc prévenu les Lefontaigner que je venais passer une semaine dans le manoir, le temps de faire l'état des lieux, de rencontrer le notaire et de gérer la transition.
Ils m'ont répondu qu'ils habitaient la maison et que c'était trop tôt, que ça n'avait pas de sens de ressortir cette vieille histoire, que je ne devais pas venir.
J'ai répondu que ce n'était pas grave, que je leur laisserai bien sûr quelques semaines pour déménager, mais que je venais faire les papiers maintenant quand même, de cette manière les choses seraient claires, et que je les embrassais, et j'ai raccroché.
Oui le téléphone existait. Sauf qu'il était branché au mur, et que l'on raccrochait vraiment le combiné en le posant dessus, d'où le terme.
Le transport des bagages fut terrible entre les gares de Paris où je suis passée du train à grande vitesse direct au train à petite vitesse qui s'arrêtait dans mille gares de villages à la population en voie de disparition.
Sur le chemin, ce n'est pas sur l'aide des cadres dynamiques que j'ai pu compter. Trop pressés, trop surchargés par leur petite mallette, sûrement. Je remercie donc, un jeune maigre au regard paumé, et cette jeune fille noire, pour leurs efforts et la douleur dans leurs bras. Je ne remercie pas le quadragénaire blanc bien sur lui, qui m'a conseillé, une fois la jeune africaine partie, que je ne devrais pas laisser ma valise entre les mains d'inconnus, enfin, plutôt, de ces gens-là, car ils se seraient sûrement enfuis avec. Ajoutant que j'avais eu de la chance que ce ne soit pas arrivé. Les efforts de ce sale con pour faire sa leçon de pseudo-morale - mais sûrement pas pour faire un effort physique - m'avaient épaté. Aussi, je serais bien curieuse de voir à quelle vitesse un voleur à la tire pourrait s’enfuir avec mes bagages en main. Et enfin, si le voleur réussissait son coup, j'aimerais voir sa tête quand il comprendra qu'il a durement acquis des kilos de papiers et les effets personnels d’une vieille dame, dont une livre de médicaments. Désolé, il n'y a pas d'électronique là-dedans.
Mais finalement, je pus m'asseoir dans le train avec mes bagages à mes côtés. L'un des deux posé dans le porte-bagage du haut, grâce à l'aide d'un sportif trop content de montrer ses biceps se gonfler (c’était légitime).
Le wagon était mi-plein.
Mais au bout d'une vingtaine d'arrêts, nous n’étions plus que cinq. À l'approche de mon arrêt, plus que deux. Mon sportif était parti. L'autre voyageur était un garçon à l’allure étrange qui était monté à l'arrêt précédent. Grand, maigre, et les cheveux peroxydés.
Le train s'arrêta et nous nous levâmes tous les deux. Je sortis ma valise dans le couloir en la tirant, puis je me suis relevée en me tournant vers lui, prête à lui demander de l’aide. Il était déjà à ma hauteur. Surprise, j’eus à peine le temps d’ouvrir la bouche qu'il tendait déjà son bras pour prendre le sac, et il me fit signe d'avancer.
Il arborait un sourire constant, évocateur d’une sérénité heureuse, me dis-je.
De près, je pus voir que même ses sourcils étaient blancs. Et je pus sentir que son dernier bain remontait à longtemps.
Il porta mon sac jusqu'à la sortie du train. Sur le quai, je tâchai de ne pas perdre un instant.
— Merci beaucoup, jeune homme. Pouvez-vous continuer de le porter jusqu'à la sortie de la gare, lui demandais-je ?
Il opina de la tête. Il n'avait même pas posé le sac, qui semblait étonnamment léger sous son bras. J'allais re-empoigner ma valise, mais il me stoppa d'un signe pressé, et la souleva de l’autre main. Comme pour le sac, il semblait faire autant d'effort que si elle était vide.
Il n'avait pour bagage personnel qu'un sac en bandoulière, qui lui laissait les deux mains libres.
Je marchais devant et lui emboîtat tranquillement le pas. Nous avons traversé le hall de la petite gare et sommes arrivés sur la place principale - et unique - de mon village d'enfance que je n'avais pas vu depuis si longtemps.
Mon dieu… !
Rien n'avait changé !
En fait si, bien sûr. L'épicier s’était transformé en supérette. Cette croix verte clignotante de pharmacie n'était pas là avant - il n'y avait même pas de pharmacie. Cette maison avait totalement changé. Un tas de détails avaient changé. Mais dans l'ensemble, j'étais sur la place de mon village et je la reconnaissais parfaitement.
Je repris mes esprits.
— C'est très gentil, merci. Tu peux les poser là, j'attends mon chauffeur, lui dis-je.
Le garçon posa les bagages près de moi, et sans un mot, il s’éloigna vers la droite, et emprunta la première rue.
La place était presque vide en ce début d'après-midi de semaine.
Je fis quelques pas vers la cabine téléphonique. Son contour en bois était remplacé par des murs de verre, mais j'aurais juré que c'était le même combiné rouillant qu'il y avait dedans.
Je mis une pièce et je composais le numéro.
Je le connaissais par cœur, depuis toute petite ! Tout ce que j'avais à faire, c'était d'ajouter 03 devant.
— Allô ?
Je m'étonnais presque de reconnaître si facilement la voix désagréable d’Édouard Lefontaignier. Il devait avoir entre quarante et cinquante ans maintenant, et semblait ne pas avoir pris une once de savoir-vivre.
— Bonjour, c'est Janine. Je suis à la gare, lui dis-je.
— Quoi ? Vous êtes venue ?
— Mais oui, j'avais dit vendredi. C'est aujourd'hui. Vous venez me chercher ?
— Pas question ! Rentrez chez vous ! Me lança-t-il.
Ce petit oiseau me courait sur le système. Et vous savez, nous les vieux, avons un pouvoir. Pour nous, toutes les personnes plus jeunes que nous sont des enfants. Et nous avons un droit d'éducation sur eux, que ce soient les nôtres ou pas.
— Dites-donc, Édouard, quelles sont ces façons ? Ne faites donc pas attendre une vieille dame. Je vous attends.
— Mais... Jacques !!
J’entendis un coup sec, il venait sans doute de poser le combiné sur la table, et j’entendis ses pas s’éloigner. Je perçus vaguement une discussion animée qu’il devait avoir avec le Jacques qui venait, semble-t-il, d’arriver. La voix d’Édouard était hystérique. J’entendis de nouveaux des pas s'approcher et ensuite une nouvelle voix calme et posée.
— Madame Bronsard, nous ne pouvons pas vous accueillir. Prenez un billet retour et rentrez chez vous. Au revoir.
J'allais répondre, mais il raccrocha.
Ooooh, voilà un adversaire à ma hauteur, me dis-je. Ne savait-il pas que les vieilles ont un nombre infini de pièces de monnaie sur elles ?
Au jeu du dernier mot, j'avais l'avantage : je connaissais leur numéro et eux ne connaissaient pas celui de la cabine.
Je rappelais. Ça sonna plus longtemps. Et enfin, sans doute excédé, Édouard décrocha. Il voulut commencer à parler, mais je l’interrompis :
— Écoutez---
— Je vous attends à la gare.
Et j'ai raccroché.
Je me suis ensuite dirigée vers mes bagages et m’assis sur ma valise.
J'ai attendu.
Assez vite, le garçon à la pilosité blanche revint sur la place, venant de la deuxième rue. Il contourna la dernière maison et s'engagea dans la troisième rue.
Un petit vent frais vint rafraîchir cette chaude journée d’été.
Un passant arriva de la troisième rue et entra dans le bar de la place qui était ouvert. Je pourrais y aller, me dis-je, ne fût-ce que pour voir qui était le nouveau patron... mais ce n’était pas mon envie du moment.
J’entendis le son d’une voiture en approche, et qui s’éloigna ensuite...
Bon, le temps commençait à devenir long ! Le trajet de la maison à la gare, en voiture, c’était même pas vingt minutes !
J’ai peut-être bluffé un peu trop fort... ils n’allaient pourtant pas me laisser là... ils savent que les trains sont rares. De plus, le retour de bâton serait énorme. Ils n’ont plus le droit d’être là, et le père d’Édouard restait une personne décente qui ne laisserait pas passer un tel comportement.
Presque deux heures plus tard, je me décidai à téléphoner à nouveau.
Ça sonna sans réponse. Au bout d’un long moment, je raccrochai, et me rassis.
Le soleil descendait à l’horizon, se cachait derrière les maisons.
Le blanc garçon arriva de nouveau sur la place, par la quatrième rue. Il me jeta un regard étonné, mais je ne lui rendis pas. C’était pas ses affaires. Il tourna et s’engagea dans la cinquième rue.
— Il visite toute la ville celui-là, me disais-je...
Les lampadaires (pas ceux de mon souvenir) s’allumèrent. Le ciel prit plein de couleurs. Dans la platitude de ce pays, le soleil restait visible longtemps.
Une ou deux fois, je téléphonai à nouveau, sans réponse.
Il était maintenant 21 heures, il faisait nuit, et il fallait que je prenne une décision. Il n'y avait sûrement plus aucun train. Il n'y avait pas non plus d'hôtel. Je pouvais marcher jusqu'au manoir, j'y serai en peut-être deux heures, mais pas en traînant ces monstrueux bagages. Je me mis alors en quête d’un endroit tranquille où je pourrais les laisser... avec un petit mot dessus. Dans ce village vide, le risque de vol était faible, et le concept de destruction des bagages oubliés n'était encore arrivé dans la tête de personne.
Arrivant de la dernière rue, le jeune homme aux cheveux blancs réapparut et, à ma vue, s’immobilisa, interdit. Il s’avança d’un pas rapide vers moi. Puis, au lieu de me demander pourquoi j'étais encore là, il me regarda en penchant la tête de côté, avec des yeux de cocker ! Une façon silencieuse mais évidente de me dire : Eh bien ? Qu'est ce qui ne va pas ?
J'étais prise en pitié par ce vagabond à qui j'aurais plutôt donné une pièce dans la rue !
Mais je gardais ma contenance, comme en toute occasion, et je lui dis :
— Il semble que mon chauffeur n'ait pas pu venir, après tout...
Il prit un air embarrassé. Sans voiture, il ne pouvait en effet pas m'aider. Pas plus que m’offrir un toit ! Il demeurait immobile, devant moi, dans la même expression et sans un mot. Cela commençait à me courir.
— Tu comprends le français, mon garçon ?
Il opina immédiatement de la tête.
— Tu ne peux pas parler ?
Même signe.
Oh, il était muet.
Ça me frappa à ce moment. De ma longue vie, je n'avais jamais rencontré de sourd-muet. Enfin, celui-là n'était pas sourd. Je croyais que ça allait ensemble. Je ne sais pas.
— Mes excuses, jeune homme, lui dis-je. Bon... eh bien je vais rejoindre la maison à pied, moi, ajoutais-je ensuite...
Il prit alors un air enthousiaste et posa la main sur la poignée de ma valise.
— Oh grands dieux, non ! Je vais laisser ça ici. Tu n'as pas besoin de m'aider. Merci quand même.
Et là, il me fit vigoureusement non de la tête. Il souleva la valise, prit le sac dans l'autre main, et se plaça sur mon côté, légèrement en arrière. Le buste en avant, il avança sa tête d'un grand mouvement, ce qui voulait clairement dire : Montrez le chemin, je vous suis.
— Il y en aura pour deux heures de marche, ajoutais-je, certaine de le décourager...
À l’inverse de quoi il haussa les épaules, me montrant à nouveau à quel point pour lui, porter mes bagages ne nécessitait aucun effort. Et ceci en dépit de l’aspect chétif de sa constitution.
Je commençai à traverser la place. Il suivait.
— Tu sais où tu dors, ce soir ? lui demandais-je en me tournant vers lui.
Il souleva une main aussi aisément que si elle portait un petit sac plastique, et tendit l'index sans lâcher la poignée. Il pointait sur un banc public de la place.
— Évidemment...
Alors qu'on avançait dans la quatrième rue (toutes ces rues ont des noms, mais j'ai considéré plus simple de les nommer par numérotation. De plus, je parie que vous ne connaissez aucune des figures de la grande guerre qu'elles portent), je scrutais chaque façade, cherchant à retrouver des souvenirs. Généralement, ça ne me disait rien, et puis d'un coup, une fulgurance, une vieille maison qui semblait sortir d'une machine à voyager dans le futur, partie de mon enfance pour me retrouver maintenant, identique, à la craquelure près. Il y en eut plusieurs comme ça jusqu'à la sortie de la ville, mais je ne m'attardais pas. On les voyait mal dans la nuit, et je ne voulais pas imposer des arrêts, par simple nostalgie, à mon porteur. J'aurai tout le temps de les voir dans les jours qui suivent.
Il marchait à ma vitesse sans que cela ne semble l'ennuyer le moins du monde. Au début de la marche, je m'étais présentée :
— Je m'appelle Janine, enchantée.
Il avait fait un signe de la tête.
— Et toi, il y a moyen de savoir comment tu t'appelles ?
Il fit encore oui de la tête sans plus. Puis quelques mètres plus loin, alors qu'on était sous un lampadaire, il s’arrêta et sortit d'une poche une petite carte. Il me la montra. C'était un carton qu'on portait à la chemise dans les événements publics, ou qu’un serveur de restaurant pourrait arborer.
— Bonjour, enfin bonsoir, Joël.
Il rangea sa carte et reprit la marche. Ça aura été la seule information claire qu'il n'aura jamais donnée. Et je dis « claire ». Je ne sais même pas si elle est vraie.
Enfin nous arrivâmes à la dernière maison. Au-delà commençaient les terrains vagues et plus loin encore, des champs. La rue était un peu plus longue qu'avant. Ils avaient construit, mais pas tant que ça. Les fenêtres au contour en plexiglas de la dernière maison donnaient un indice sur son âge.
C'était la fin du trottoir et des lampadaires.
Il faisait beau et cette grosse demi-lune nous permettrait peut-être de nous en sortir.
— À partir de là, c'est sûrement une heure de marche dans le noir, dis-je.
Il me répondit du même hochement de tête d’approbation et reprit la route.
Très vite, je ne vis plus rien des contours du chemin. Heureusement, la route était encore goudronnée. Et mon Joël aux cheveux blancs restait bien visible. Il avançait d'un pas certain, ce que j'attribuais à l’acuité performante liée à son jeune âge. Je le suivais, en essayant d'avoir l'air de simplement marcher à côté de lui.
Au bout de quelques minutes, je trouvais que cette nuit noire était tout de même bien angoissante pour moi. Marcher aux côtés de cette personne, envers qui j'avais pourtant développé intuitivement une grande confiance, n'était pas si rassurant. Car une autre partie de mon cerveau, plus rationnelle, me rappelait qu’il s’agissait d’un vagabond que j'avais à peine rencontré. Si je me faisais tuer dans le noir sur le chemin du manoir, me dis-je, ça causerait au moins des problèmes à Édouard Lefontaigner, et ce serait bien fait pour lui.
Alors pour tromper mon ennui et ma peur de l'obscurité, je me mis à bavarder, lui racontant ce que je venais faire ici. L'avantage, c’était qu'il écoutait très bien et ne me coupait jamais.
Au bout d'un moment, il en savait autant que vous.
Je m’interrompis alors au milieu d'une phrase par un hoquet d'excitation en voyant une lumière au loin. Sur la droite. Pas de doute !...
— C'est là... fis-je avec un trémolo dans la voix, auquel je ne m'attendais pas.
Nous nous avançâmes un peu puis quittâmes la route pour entrer dans le chemin de terre d'une cinquantaine de mètres en direction du portail. Il distinguait à l'évidence ce chemin très bien, mais il me fallut plus de temps pour que les lumières venant des fenêtres de la maison éclairent quelque chose pour moi. Nous sommes ensuite arrivés devant le portail, dans le noir, en plein contre-jour. La sonnette n'avait pas changé et je la fis retentir.
Ça ne vint pas à l'idée de Joël d’en profiter pour enfin déposer les bagages au sol.
Au loin, je vis la grande porte de la maison s'ouvrir. Un homme apparut en contre-jour, avançant la tête, l’air tout étonné. Il tendit un bras et subitement, une puissante lumière m'aveugla. Sur le mur prolongeant le portail, un énorme spot avait été installé, et éclairait toute la zone de fin du chemin de terre. Quand mes pupilles furent assez rétrécies, je vis Édouard s’avancer d'un pas pressé vers le portail et dès qu'il fut à portée de voix, il s'égosilla :
— Mais qu'est-ce que vous faites ici ?!
Ooooh, je n'allais pas répondre à cette question.
— En voilà des façons !! Vous ne trouvez pas que vous en avez assez fait, en m'abandonnant à la gare ?, lui répondis-je, agacée.
Édouard se retrouva planté devant nous, l'air confus et paniqué. On sentait qu'il aurait voulu nous voir disparaître sur le champ, qu'il brûlait de nous ordonner de partir, mais à la fois conscient qu'il ne pouvait pas décemment le faire. Il sortit une clef de sa poche.
— Je... Je vous avais dit de ne pas venir ! se justifia-t-il maladroitement, essayant d’en faire un reproche.
— Édouard, je vais me fâcher. Cessez ça et ouvrez-nous. J'ai un invité.
Il tourna la clef dans le portail et le tira à lui. Son mouvement était au début rapide, poussé par la peur, la pression que je lui mettais, puis il devint de plus en plus lent, hésitant. Il regardait mon porteur avec la plus grande appréhension du monde, hésitant sûrement à inverser le mouvement pour nous claquer le portail au nez. Mais il se ravisa et j'entrai dans le jardin de mon enfance. Mes pieds grattaient le gravier de ma jeunesse. Mes yeux devinaient la forme du grand arbre à balançoire de mon adolescence.
Joël suivit et passa à côté d'Edouard qui s'accrochait au portail comme à une bouée. Puis, alors qu’il le frôlait, il eut un brusque mouvement de recul : il avait senti son odeur...
Édouard referma consciencieusement le portail à clef pendant que nous avancions vers la maison, puis il courut derrière nous pour nous rattraper. Je me tournai vers lui.
— Puisque vous n'avez pas eu l'amabilité de venir en voiture, Joël a dû porter toutes mes affaires seul sur des kilomètres ! Vous pouvez au moins l'aider sur la fin...?
Édouard regarda les deux gros bagages avec hésitation, puis approcha du côté où Joël tenait le sac, ayant sûrement immédiatement jaugé que c'était le plus léger. Dans un sourire, ce dernier lui tendit le sac en le soulevant à bout de bras.
Mais c'était le plus lourd. Une fois pris en main, et lâché par mon porteur, le sac s’écrasa au sol, pliant Édouard en deux.
Encore plus embarrassé, et au prix d'un effort considérable, il se redressa et réussit à arracher le sac de toile de sa prison de graviers. Il nous suivit laborieusement sur le chemin qui menait à la porte encore entrouverte, en soufflant bruyamment à chacun de ses pas.
Le hall d'entrée avait cette luminosité familière, c’est-à-dire mal éclairé. Même cent ans après, même avec de meilleures ampoules, ce lustre était décidément trop mal conçu et mal installé. Mais toujours là. Les meubles étaient un mélange de ceux de mon souvenir et de nouveaux. Les nouveaux devaient en remplacer d'autres qui avaient été enlevés, mais sur le moment, je n'aurais pas pu lister ou décrire les manquants.
À droite, je reconnus le grand escalier en bois qui craquait. Je l'avais tant maudit à cause de ses bruits dénonciateurs qui m'avaient empêchée de faire des virées nocturnes. Il était inchangé, mais je remarquai une barre de fer qui faisait tenir un morceau de la rambarde à présent cassée.
Oubliant les deux garçons, je me dirigeais vers le salon, ne pouvant résister à mon envie de tout revoir immédiatement. Les murs étaient comme dans le hall. Tableaux, rideaux et armoires ou étagères étaient en partie conservés, en partie changés. Certaines peintures de portraits de personnes qui m’avaient toujours été inconnues avaient été remplacées par d'autres que je ne connaissais pas plus.
Le centre, par contre, n'avait plus rien à voir. Tout avait été modifié et déplacé. Une autre grande table, un autre tapis, un autre assortiment de fauteuils et de canapés, redisposés dans une dysharmonie assez choquante. C'était un contresens à mes souvenirs. Un illogisme total pour moi : pendant des décennies, aucun meuble n'avait bougé d'un centimètre ! Cette nouvelle disposition... bon, une fois le choc passé... ce n'était pas si mal.
La porte du fond était ouverte. Je m'y rendis de ce pas. Mais là, le changement était total. La salle de jeux des enfants était entièrement transformée en une sorte de fumoir. Le coffre à jouets laissait place à un canapé en cuir. Le vieux baby-foot cassé était remplacé par un billard neuf.
Des objets adultes et ennuyeux jonchaient le sol à la place des petits jouets enfantins qui naguère faisaient office de pièges à orteils. Adieux poupées, chevaux, bonshommes de plastique ou de plomb, jeux de société empilés. Bonjours cendriers, minibar à whisky, œuvre d'art en fil de fer, livres sans images empilés.
Et... quelle horreur... une télé.
Des pas pressés approchaient. Pas ceux de ce lourdeau d’Édouard... Ni de Joël, que je ne pouvais imaginer pressé. Énergiques et légers, il devait s’agir d’une femme. En retournant dans le salon, je tombais nez-à-nez avec un véritable cliché de femme de chambre. Elle portait une blouse noire surmontée d’un tablier blanc à froufrous, vraiment ! Elle arborait un chignon serré et un visage ridé qui ne devait pas avoir souri depuis vingt ans.
— Je prépare la chambre de Madame ?
Mais dans quel siècle vivait-elle ? Ou plutôt vivait son employeur ?
— S'il vous plaît, lui répondis-je. Et une autre pour mon ami.
Sans rien ajouter, elle me tourna le dos et disparut vers l'étage.
Apparut alors, venant du hall, un grand homme sec affublé d’un costume trois pièces - à l’heure du coucher ? -, le visage creux et dépourvu de toute expression.
— Madame Bronsard, me dit-il d’une voix d’outre-tombe, et, me sembla-t-il, comme s’il se parlait à lui-même.
— Votre clochard n'a pas daigné donner son nom. Est-il trop demeuré pour parler ? Poursuivit-il.
La condescendance qui suintait de chacun de ses mots était telle qu'elle devenait risible.
— Il est trop muet pour parler, lui répondis-je. Et vous, quelle est votre excuse ?
— Maître Jacques Langlois, chère Madame.
Sa façon d'ignorer mes remarques était de nature à me faire sortir de mes gonds. Heureusement pour lui, j'étais fatiguée et aspirais à me coucher au plus vite.
— Ravie de faire votre connaissance, lui répondis-je, nous aurons l’occasion de nous revoir demain. Je vous souhaite une bonne nuit.
Je le contournai et entrai dans le hall. Joël y était encore, et il accompagnait du regard, non sans un léger sourire de satisfaction, la lente et pénible ascension d’Édouard dans les escaliers, soufflant et haletant sous un effort décuplé par le poids du sac.
Joël savait qu'il passait la nuit ici. Il m’avait semblé naturel de l’inviter vu les circonstances et a fortiori en sachant qu’il n’avait pas de toit. C’était au détour d'une phrase alors que je monologuais sur la route noire. Je ne pouvais pas, pendant ma description du manoir, parler des chambres sans ajouter : Il y en aura une pour toi, bien sûr. De toute façon, dès lors que nous avions quitté le village, il était évident qu'il était invité. Je ne pouvais pas le laisser sur la route.
— Je suis épuisée. Je pense que nous avons mérité du repos, surtout toi mon petit. Allez, un dernier effort pour monter jusqu'à nos chambres ?
Il acquiesça et me suivit dans les escaliers. On entendait Édouard respirer lourdement en haut. Le couloir m'accueillit avec lui aussi ses bouffées de souvenirs.
La femme sortit d'une chambre à défaut d'une pièce de théâtre de boulevard.
— Puis-je savoir où je pourrais dormir ? Lui demandais-je gentiment, m’efforçant de contenir mon impatience et de rester aimable. Je n’en pouvais vraiment plus.
— Cette chambre est prête, me répondit-elle en pointant du doigt celle dont elle venait de sortir.
Je n'avais pas fait un pas que Joël s’était déjà précipité à l’intérieur pour y déposer mes bagages. Il ressortit ensuite et me salua d’un hochement de tête accompagné d’un petit signe de la main. Il me souhaitait une bonne nuit. Enfin, d'après moi.
— Bonne nuit Joël, lui répondis-je.
Une fois dans le couloir, la femme lui demanda de patienter, sa chambre n'était pas encore prête. Il lui répondit par un sourire et ouvrit une porte.
— C'est la salle de... dit-elle. Mais il était déjà entré, l'ayant à l'évidence deviné, et referma la porte derrière lui. J'entendis le loquet tourner.
Je me dis que le bonhomme devait être ravi de pouvoir profiter d'une vraie salle de bain.
Je remerciai à nouveau la femme de chambre, songeant qu’elle ne devait pas souvent bénéficier de ce genre d’égard élémentaire dans cette maison. Mais ça ne sembla lui faire ni chaud ni froid et sans un mot, elle disparut dans une autre chambre.
Je fermai la porte, me débarrassai de quelques vêtements, et me glissai directement sous les draps. Je m'endormis immédiatement.
Les rêves n'ont aucun sens, et en plus on les oublie très vite. Je crois dire vaguement que j'étais dans le train. Il y avait Édouard assis en face de moi. Au début avec son physique actuel, puis tel que je l'avais connu à l'époque. Par la fenêtre je vis Joël en position assise dans les airs sur un siège invisible, qui avançait aussi vite que nous, puis il était dans le train, et n'arrêtait pas de parler. Ensuite je marchais, marchais longtemps, seule, dans le train puis dans la rue, puis je remarquais que je n'avais plus mes bagages alors je faisais demi-tour, je courais en soufflant, mais de retour à la gare il n'y avait pas de train, il n'y avait même pas de rails.
Je crois vraiment que j'aurais oublié tout ça si je n'avais pas été réveillée par des jurons étouffés et des tambourinages sur une porte.
Je me mis debout. Il faisait encore nuit noire. J'allumai une petite lampe et ouvris ma valise, en sortit un châle, le posai sur mes épaules. Ainsi présentable, je sortis de ma chambre. C'était Édouard qui frappait à la porte de la salle de bain, exaspéré.
Il se tourna vers moi et je lui demandai :
— Vous ne dormez pas à cette heure ?
— Lui non plus ! Je veux savoir ce qu'il fout là-dedans depuis des heures ! Il ne répond pas, il doit être totalement drogué !
— Évidemment qu'il ne répond pas, il est muet.
— Hein ? Ah. Mais, qu'est ce qu'il fait là-dedans ?
Joël ne dormait pas, on pouvait entendre des petits bruits. Alors que j'avançais, Édouard me laissa immédiatement la place devant la porte. Je frappais légèrement la porte en demandant :
— Joël, tout va bien ici ? Nous nous inquiétons.
Sans hésitation, le loquet se tourna.
Puis la porte s'ouvrit sur un étonnant spectacle.
Son sac était ouvert, vide, par terre. Il n'avait contenu à l'évidence que des vêtements, qui étaient à présent tous mouillés et étendus partout dans la salle de bain. Sur les porte-serviettes. Sur le rail du rideau de douche. Sur les bords de la baignoire... le lavabo rempli d'eau témoignait de ce qu’il était en train de faire... Joël faisait la lessive !
Il profitait bien en effet de l'occasion de son accès à la propreté. Il lavait à la main tous ses vêtements. Et je dis bien tous. Il était totalement nu, et pas du tout gêné de l'être.
Ses poils pubiens étaient aussi blancs que ses cheveux.
Édouard resta quelques secondes sidéré. Il cherchait des mots. Il balbutiait des onomatopées. Puis finit par articuler :
— Bon hein là, c'est la nuit là, il faut se coucher maintenant !
Joël lui jeta un regard aussi désarmant que celui d’un chat que son maître n’arrive pas à sermonner. Il retira ensuite le bouchon de l’évier et essora son dernier vêtement, le déplia et le posa sur la dernière place possible pour l'étendre. J’eus un sentiment étrange, c'était le dernier vêtement et toute la salle de bain était occupée. Il me semblait que sa taille et ses divers supports avaient été faits pile pour étendre toutes ses affaires exactement. Et que mon arrivée s’était synchronisée avec la fin de sa lessive. Je ressentais qu'il y avait quelque chose de magique dans tout ça. Ou alors j'étais tout simplement dans le pâté.
Il prit une serviette sèche dans l’étagère, la jeta sur ses épaules, et sortit dans le couloir. En passant devant nous, on put constater qu'il s'était aussi lavé. Mais il était déjà sec. La fonction de cette serviette n’avait pas de sens, Pourquoi l’avait-il mise sur les épaules, en cape, plutôt que de s'entourer la taille et ainsi cacher son intimité comme tout le monde ?! Nous le regardâmes s'éloigner de dos, à moitié nu, puis entrer dans sa chambre, et fermer la porte.
J’allais alors me recoucher, laissant Édouard, tout hébété, dans le couloir.
Le lendemain matin, je m'apprêtais à passer une heure dans la salle de bain comme d'habitude, mais me rappelais qu'elle devait être trop encombrée. Avant d'aller dans une autre plus éloignée et plus vétuste, je vérifiais par curiosité.
Vide, comme si j'avais rêvé cette nuit. J'avais sûrement rêvé cette nuit.
Une heure et demie plus tard... En descendant les escaliers j'entendis des bruits divers qui rappelaient le souvenir chaleureux des petits déjeuners sur la terrasse à la campagne. Je suivis les tintements de porcelaine et sortis à l'opposé de l'entrée de la maison, vers la terrasse. Les dalles d'où s'échappaient des brins de mauvaises herbes. La table en fer forgé. Des chaises remplacées mais qui semblaient quand même de goût et confortables. Le tout toituré par la merveilleuse tonnelle toujours là, même si en mauvais état et manquant cruellement de plantes feuillues, elle ressemblait à un grillage de bois oubliant sa raison d'existence.
Joël était là et mangeait avec appétit - et je me disais que ça ne lui faisait pas de tort.
Ce qui était à table avait de quoi mettre de bonne humeur. Du café, du thé, des bols et des tasses prêtes à l'emploi, sucre, confiture, pains et croissants, quelqu'une s'était levée tôt pour passer au village.
Les autres convives par contre, renfermés, détonnaient dans cette ambiance de publicité Ricoré (cherchez sur internet pour savoir de quoi il s'agit, les jeunes). Édouard, mal à l'aise, avec devant lui un croissant à peine entamé, et une tasse de café dont un tiers s’était déversé sur la nappe. Le sinistre Jacques regardait Joël manger avec la curiosité d'un visiteur de zoo au pavillon des grands singes. Devant lui, une assiette propre, une serviette en papier encore pliée et un verre vide mais dont l’infime trace de pulpe sur le rebord, trahit qu’il avait en fait déjà bu et mangé. Mais laisser des miettes et des serviettes froissées, c'était pour les gens qui savaient vivre, pas pour lui. Les deux hommes faisaient peser un lourd silence.
Je les saluai par politesse et m'émerveillai de ce petit déjeuner.
— Bonjour, Janine. répondit Édouard d'un air absent.
Jacques tourna lentement la tête vers moi, sans un mot, ni signe de tête. Il me trouva comme s'il avait cherché l'origine d'un bruit.
Joël me considéra de façon plus humaine et polie. Il m'avait repéré dès mon arrivée et m'avait déjà fait un signe, mais là il m'en fit un autre, plus lent. Son posé de tête sur le côté disait magnifiquement : Bonjour, avez-vous passé une bonne nuit ?
J'en étais presque sûre mais je n'osais pas répondre tout haut à une question qui n'avait peut-être jamais été posée. Je lui rendis un sourire, tirai une chaise et commençai à m'asseoir.
À ce moment, un type arriva par le jardin, et tout est allé très vite.
À peine l'inconnu venait-il d'être en vue que Joël se leva et se retourna d'un coup, lâchant viennoiseries et renversant sa chaise. Je n'eus pas le temps de commencer à me demander pourquoi, que le type sortit de je ne sais où un revolver, et sans hésitation, très calme et décidé, tira deux balles dans le ventre de Joël qui s'écroula en arrière.
Je criai tout en me levant de ma chaise!
Je pensais dire : Mon dieu, Joël !! Mais je crois que j'ai juste crié une voyelle en continu. Le type s'approcha alors et pointa son arme sur moi. Il mugit avec autorité : Ta gueule ! Et, face à ce monstre qui n'hésitait pas à tirer, je me forçai sur le coup au silence.
Jacques n'avait pas bougé et restait serein. Édouard, bien qu'aussi peu surpris que Jacques, tremblait un peu.
— Merci d'être venu aussi vite, Marcu. Dit Jacques en toute tranquillité.
— Je n'aime pas le garçon, dit le tueur. Il a retourné tout de suite, il a méfié. C'est un flic.
— Je ne pense pas, mais ça n'a aucune importance maintenant, vous l'avez eu.
J'allais dire quelque chose mais le tueur étranger re-pointa son arme sur moi. Ta gueule. Ça, il savait bien le dire.
Jacques se pencha sur Joël dont le corps tressaillait encore.
— Tout va bien, il vit encore.
— Car vous m'avez demandé. Mais je n'aime pas. C'est mieux il faut l'achever.
— S'il bouge trop, n'hésitez pas. En attendant, suivons le plan.
Le tueur utilisa sa main libre pour sortir d'une poche une paire de menottes type police, et l'envoya à Jacques. Ce dernier, toujours aussi calme, attacha les mains de Joël dans son dos. Puis il se releva et tendit une main vers le tueur. Celui-ci sortit de nouveau comme par magie un autre revolver qu'il lui donna. Jacques pointa sur moi. Le tueur pointa sur le corps de Joël et ne le lâcha pas des yeux, perpétuellement méfiant.
— Bon, Édouard, vous traînez le parasite. Et vous madame, vous passez devant, la suite se déroule à l'intérieur.
Seuls en rase campagne. Inutile de crier. Inutile de courir. Accablée, je passais la porte-fenêtre ouverte. Jacques me suivit en restant à un mètre de distance. Derrière lui, Édouard tirait le corps de Joël par les pieds, dont je vérifiais par maints coups d'œil qu'il bougeait encore. Fermant la file, le Marcu était attentif à tout. Jacques, qui ne se formalisait pas de mes regards inquisiteurs tant que j'avançais, remarqua ma curiosité pour ce tueur.
— Comme vous avez ignoré mes conseils et êtes venue finalement, de plus avec ce vagabond, nous avons dû appeler Marcu en urgence. À gauche. Professionnel et dévoué, il n'a pas hésité à nous rejoindre au plus vite. Prenez le couloir. Il est toujours de bon conseil, comme d'avoir suggéré de nous occuper de vous après une bonne nuit de sommeil. Par contre, il voulait aussi vous tirer dessus. Oui oui, vers la cuisine. Mais je pensais qu'il serait plus agréable de vous faire marcher que de tirer deux corps. J'ai eu raison, non ?
J'entretenais un espoir de survie mais commençais à désespérer. Qu'allaient-ils faire de nous ?
— Stop. Dit Jacques avant que j'entre dans la cuisine. Sur votre gauche. Il y a une porte.
Mais c'était un mur à ma gauche... Je ne comprenais pas. Et je n'étais pas en position d’émettre la moindre remarque.
— Regardez, concentrez-vous.
Je restais hébétée, n'osant le contredire. N'osant répondre. Il n'y avait pas de mécanisme caché, de chandelier à tourner. C'était un banal mur vieillissant, sans tableau ni rien accroché dessus.
— Bon sang, fit Jacques qui perdait déjà patience, il avança d'un coup entre moi et ce mur, j'eu un mouvement de recul. Mauvais réflexe. Je le regrettai tout le temps qui suivit : et si je m'étais jetée sur lui pour lui prendre son arme ? Je n'avais sûrement aucune chance, mais mon destin actuel en avait-il plus ?
Devant mes yeux ébahis, il ouvrit une porte. À cet instant, il y avait une porte tout à fait banale et très visible sur le mur. D'ailleurs bien sûr ! C'était la porte de la cave ! Je la connaissais très bien, je savais bien qu'elle était là, avant la cuisine ! Comment avais-je pu l'oublier ? Comment avais-je pu ne pas la voir ?
Je ne pus y réfléchir plus longtemps. Reprenant le contrôle, Jacques me fit signe du bout du revolver de descendre les escaliers.
Mais il ne me suivit pas. Il redonna son arme à Marcu, et fit le tour du corps de Joël. Il se baissa, en demandant au tueur :
— Vous passez devant ou derrière nous ?
— Derrière. Je ferme passage de la sortie. Toujours.
— Bon.
Il souleva Joël par les épaules et avec Édouard commencèrent la descente de l'escalier en faisant attention à lui éviter des chocs. Cet égard envers lui me donnait un léger espoir, mais je ne comprenais toujours pas où cela nous menait.
La cave était plus grande que dans mes souvenirs. Mieux éclairée, et ne ressemblant en rien à une cave. À part son sol bétonné et un peu ensablé, ses murs nus sans rien accroché, on n'y retrouvait que des objets d'extérieur ou de salon. Une grande table sculptée. Des coffres-forts près des murs. De confortables fauteuils, dirigés vers le fond de la salle. Au fond, tout était noirci de suie, mais aucune trace de bois ni de cheminée.
Je marchai jusqu'au milieu de la pièce et tournai sur moi-même, désemparée, espérant voir par magie une porte de sortie, ou un escadron entier de police, prêt à nous sauver. Jacques et Édouard continuèrent jusqu'au fond de la pièce où ils déposèrent Joël, sur le sol noir. C'est là que j'ai vu les chaînes incrustées au mur. Sales, noires, et avec des taches rouge sombre...
Marcu resta en bas des escaliers. Il me jeta un regard lourd de sens, il était inutile de penser à fuir par là.
À la place, j'accourus vers Joël. Jacques s'en éloignait déjà et Édouard repartait vers la grande table, en évitant soigneusement mon regard. Je m'accroupis et posai mes mains sur lui, l'appelant doucement. Son tee-shirt -tout propre- baignait presque entièrement dans son sang. Les yeux grands ouverts, il devait voir danser devant lui des lumières merveilleuses et mortelles. Pourtant, malgré son état délirant et sa fièvre évidente, il me regarda et me fit un grand sourire. Le même que ceux dont il m'honorait la veille, qui accompagnaient l'évidence de rendre un petit service, comme de porter une valise hors du train, ou sur dix kilomètres, ou de mourir pour moi.
Je sentis les larmes couler sur mes joues.
— Vous êtes rassurée ? Il est bien en vie. C'est que nous avions besoin de vous vivants. Sinon ça ne marche pas.
Jacques qui était à deux mètres venait de me parler. Je me tournai et lui offris un visage plein de rage. Qu'il ignora totalement.
— Maintenant venez ici.
Je me relevai et remarquai qu'il était juste à côté des chaînes.
— Non, m'entendis-je répondre.
Jacques se répèta, simplement.
— Venez ici.
— Non.
Il me lança un drôle de regard. Et s'approcha à pas pressés. Je mis inutilement mes mains devant moi pour me protéger, mais il ne me força pas. Il passa à côté de moi et donna un grand coup de pied dans le ventre de Joël !
— MON DIEU MAIS ÇA NE VA PAS VOUS ÊTES MALADE !!
Sans me regarder il revint vers les chaînes, puis se tourna vers moi.
— Venez ici.
La mort dans l'âme, je le rejoins.
Approchant un fer, il me fit un geste et je compris qu'il attendait mon poignet. Je le tendis avec appréhension. Il supprima mon dernier espoir de mouvement en le cadenassant définitivement. C'était solide et froid. Puis il s'éloigna vers Édouard.
— Mais... que faites-vous ?
Il était temps que je demande, car ça faisait longtemps que je ne comprenais rien.
— De la magie noire.
— Que... que, hein quoi ?
À la grande table, Édouard avait feuilleté un énorme vieux livre et s'était arrêté à une page particulière. Jacques jeta un coup d'œil et opina de la tête.
— Oh, je n'y crois pas plus que vous. Nous ne sommes pas des adorateurs du diable, qui d’ailleurs n'existe sûrement pas, ni des sorciers. Nous avons simplement la bonne documentation, et il s'avère qu'en suivant les bonnes méthodes, ça marche.
Le bruit de l'ouverture d'un coffre attira mon attention. Ce n'était pas un coffre-fort mais un petit frigo, bien qu'il semblait blindé. Édouard en sortit un flacon rouge. Il attrapa ensuite un petit verre vide d'une étagère à côté, tout était bien rangé. Avec des gestes précis qui trahissaient l'habitude, il versa une petite partie du liquide dans le verre.
— Du sang de poulet, commenta Jacques. En fait, tout oiseau marche, mais pas celui des mammifères, allez savoir pourquoi. La température et la quantité importent peu.
Édouard s'approcha de Joël et lui laissa tomber quelques gouttes du verre sur le corps, puis, d'un geste ample, jeta le reste sur moi, sans s’approcher.
— Ça ne va pas ? Fis-je en me frottant le visage.
— Il faut bien désigner les sacrifiés, expliqua Jacques sans se retourner.
Édouard rejoint Jacques, qui le scruta de près. Il vérifia ses habits, ses mains, puis posa un genou à terre, baissa la tête, prenant le temps de bien vérifier ses chaussures. Aucune goutte de sang orpheline n'était tombée sur lui.
— Mais... ce n'est pas possible... dis-je, désespérée, à la merci de ces trois fous.
— En utilisant les bons termes dans la bonne langue, on obtient ce qu'on veut en échange de sacrifices humains. Le tout, c'est de demander très peu. Mais le champ d'action est très varié. Pour une vieille peau et un vagabond aux portes de la mort, on ne peut pas monnayer grand-chose. On va donc juste demander d'effacer les traces de votre passage dans le village. Ça devrait aller, vous ne vous êtes pas spécialement fait remarquer. Pour votre famille et la police, vous ne serez jamais descendue à cette gare.
— C'est n'importe quoi. Toute ma famille sait que je suis ici.
— Vous n'êtes jamais venue ici. Les flics passeront nous voir, bien sûr. Comme à chaque fois, ils seront reçus chaleureusement et feront chou blanc.
— On commence à les connaître, dit Édouard.
— Lorsqu'il y a un corps à faire disparaître, c'est ici que l'on s'adresse. Il faut dire qu'après un sacrifice, il ne reste rien, même pas un morceau d'os. On nous paye cher, mais nos clients ne savent pas que notre méthode nous rapporte bien plus encore.
— La vie d'un homme valide, on peut l'échanger contre un an d'espérance de vie. Jacques a dans les cent vingt ans.
J'ouvris de grands yeux étonnés. Je ne pouvais y croire.
— En cumulant les contrats, nous avons obtenu bien des avantages. Comme la porte de la cave magiquement camouflée, ce qui a permis deux trois visites des gendarmes sans le moindre danger.
— Leurs enquêtes sur nos clients passent parfois par chez nous, puisqu’ils voient qu’ils prennent la route passant devant la maison. Mais nous avons toujours été très coopératifs. Ils ne se sont jamais attardés, raconta Édouard, fier de lui.
— Nous avons pu guérir Marcu de son cancer, continua Jacques, et je crois Édouard que vous cumulez déjà une petite vingtaine d'années d'espérance de vie d'avance.
— Non mais... non... Mais...
Jacques lut le livre et déclama pendant deux minutes des élucubrations incompréhensibles aux reflets vaguement latins.
Je promenais mon regard pour faire un tour de la salle. Édouard s'était assis dans l'un des fauteuils. Joël toujours à terre, immobile. Le Marcu au pied des escaliers, sentinelle imperturbable.
La voix de Jacques, pareille à un acteur sur scène de théâtre, emplissait la cave, saugrenue. Il ne se passait rien et même les deux autres n'y faisaient pas attention, habitués à l'évidence à la scène.
J'allais cracher une moquerie quand je sentais quelque chose de bizarre. Ça sentait... Le brûlé. Un bruit, je me tournai. Près du mur, derrière Joël, une lueur... rouge...?
De là, venait l'odeur. Et soudain, des flammes ! De grandes larges flammes, comme des langues rouges et jaunes, sortant du sol sans raison, sans combustible, brûlant sur de la pierre, qui pourtant étaient bien là ! Elles s'étendaient dangereusement.
— Joël, attention !
Mais mes mots, aussi inefficaces que dérisoires, étaient en plus loin du compte. Soudainement ces flammes magiques n'étaient plus importantes du tout. Mais le démon qui apparaissait en leur centre, si !
Cette créature horrible se tenait sur quatre pattes, une hyène rouge grognant comme un chien enragé, de la taille d'un tigre, aux dents gigantesques et irréelles. La bête tourna vers moi un regard déferlant de haine et de malheur. Elle bougea une truffe affreuse, et je compris terrifiée qu'elle humait l'odeur du sang.
Jacques referma le livre, le posa sur la table, et s'assit tranquillement sur le second fauteuil.
L'animal m'avait choisi. Il approcha à pas lents. C'était le moment de crier. Je criai.
Mais il s'arrêta d'un coup, se retourna. Joël... s'était levé.
Il était debout, les flammes lui chatouillaient presque les pieds nus. J'ai cru qu'une brûlure l'avait forcé à un dernier sursaut du corps, mais il était droit, calme, et ne semblait même jamais avoir été blessé. Il secoua légèrement ses mains dans son dos, et avec un tintement clair au milieu du crépitement, les menottes glissèrent de ses poignets et rebondirent sur le sol, toujours fermées, comme si elles n'avaient jamais été vraiment serrées.
Édouard et Jacques bondirent de leur fauteuil, effarés. Marcu leva ses deux armes et quitta son poste. Le chien de l'enfer commença à courir vers Joël.
Je ne criais plus. Joël me regardait avec le sourire.
Le chien sauta à sa gorge. Je criai de nouveau.
Mais Joël s'était instantanément baissé, pliant les genoux, il rasa le sol de ses mains. Le monstre lui passa par-dessus. Joël se releva et trotta vers moi, marchant entre les flammes comme si elles n'étaient que des voiles légers et ondulants, à l'instar de ces décorations de restaurant.
Je n'avais pas les mots pour lui poser des questions. Il posa sa main sur mon poignet prisonnier, et en fit glisser le fer comme s'il avait toujours pu se retirer aussi facilement qu'un bracelet lâche. D'un geste, il pointa vers un coin de la salle. Et son autre main poussait gentiment dans mon dos. Je devais déguerpir. En effet les flammes étaient déjà sur moi. Enfin, près de moi, et sous lui, mais cela, comme ses bas de pantalon qui prenaient feu, ne lui semblait pas important. Avant de fuir, moi qui voyais derrière lui, j'ouvris de grands yeux et allais le prévenir, mais il réagit d'un regard confiant, qui disait : Ne t'inquiète pas, je sais que le chien me saute dessus dans mon dos.
J'échappai à la chaleur brûlante en rasant le mur, aussi vite que je pus. Je n'ai pas vu l'action, mais dès que je fus assez loin pour me retourner, je pus voir que le chien l'avait évidemment manqué, et s'était semble-t-il cogné contre le mur.
Des bruits de coup de feu. Marcu continuait d'approcher à pas rapides, en vidant ses chargeurs sur Joël. Il était certain que ce type ne manquait jamais sa cible, puisqu'il se payait le luxe de choisir les organes à transpercer chez ses victimes pour les garder en vie.
Pourtant, aucune balle ne sembla toucher le jeune garçon.
La bête se reprit. Mais cette fois, apprenante, elle ne sauta pas. Le démon galopa vers Joël et referma ses crocs sur sa cheville.
Non, sur rien.
D'un mouvement léger, le jeune homme avait retiré la jambe, tourné sur lui-même, et d'un ample coup de pied, shoota dans son flanc comme un footballeur. Comme s'il était aussi léger qu'un ballon - et il était sûrement aussi lourd qu'un taureau - le démon quadrupède vola jusqu'au fond de la salle.
Joël attendait ce court moment de répit. Il sembla prendre une position particulière. Mais un instant seulement. Marcu, le revolver vide, était déjà sur lui. Sans hésitation et marchant aussi entre les flammes, protégé de ses grosses chaussures, il essaya de le frapper à la tête avec la crosse de son arme.
Liquide, Joël glissa autour du tueur. Le bras frappeur passant devant un corps inatteignable, puis rattrapé, dirigé, emporté par une prise de judo magique, Marcu fut jeté au loin, il atterrit entre les flammes. Et s'en releva aussitôt, fuyant le périmètre, en criant de douleur et de brûlures. Ah quand même, j'allais finir par croire que cet incendie n'indisposait que moi !
En tout cas le pantalon entier de Joël commençait à héberger des flammèches. Ce qui n'était rien à côté de son tee-shirt, qui venait carrément de prendre feu ! Ce tissu léger se consuma en un rien de temps.
La bête ne fonça pas sur lui. Prouvant encore une fois son intelligence, elle avait compris que son sacrifié n'était pas de la trempe habituelle. Et qu'elle devait trouver autre chose. C'était parfait pour Joël qui se remit en position, les mains d'abord le long du corps, puis s'éloignant lentement, comme un début de mouvement de danse de balais.
Mais il fut coupé dans son élan... par moi. Je hurlai d'un coup alors que ce salaud de Jacques m'avait attrapé le bras qu'il avait plié dans mon dos ! Stupide que je suis, j'étais captivée par ce qu'il se passait au centre - et puis je ne perdais aussi jamais des yeux le monstre. J'avais bien remarqué dans mon champ de vision périphérique, Édouard courant vers une armoire et y cherchant quelque chose, peut-être une arme. Mais pas Jacques Langlois, fourbe calculateur, qui avait fait un grand tour pour me surprendre et me prendre en otage, alors que j'étais presque dos au mur !
Son autre bras serrait mon cou avec un professionnalisme qui mettait bien doute son affirmation vantarde d'être seulement avocat.
— Toi ! Dit la brute en toisant Joël dans les yeux. Pose les mains au sol, et baisse la tête.
Bien sûr. Joël avait beau être insensible aux balles et aux flammes, il évitait le démon, donc le craignait. En l'obligeant à se mettre en position de faiblesse, il ne pourrait plus esquiver ses attaques avec brio comme jusque-là...
Joël était visiblement très embêté, mais il n'obtempéra pas. Il réfléchissait à une solution. Il devait faire vite, car le monstre lui tournait autour, lentement mais en gardant ses distances, il allait être de nouveau dans son dos. Son haut entièrement brûlé, le bas de son pantalon calciné, Joël ne bougeait plus. Blanc de peau et de poils il ressemblait à un torse nu de statue grecque.
L'action était très courte, mais alors que Joël noyait ses yeux dans les miens, j'eus l'impression qu'un temps infini passait. Qu'il me transmettait quelque chose. Qu'il me disait : Allons, tu as la force, maintenant.
Je me sentais soudainement très différente. Légère. J'y voyais mieux. Je me dépliais. Je levai ma main libre devant moi pour l'observer, lisse, sans toutes ses veines qui étaient devenues apparentes au fil des décennies. Jacques était aussi surpris que moi, et faillit me lâcher, presque gêné. Mais le salaud tint bon, et allait crier une autre menace pour reprendre la situation en main...
Oh non, vieux con, la situation, je la gère !
Je tournai sur moi-même, mon avant-bras glissant dans sa main, ignorant la douleur occasionnée. Je n'avais pas eu une telle énergie en moi depuis des années ! J'étais forte et puissante ! Toujours contre lui car enserrée dans son bras, mon visage était à huit centimètres du sien. Jacques avait des yeux globuleux et perdu devant mon visage rajeuni, et il ne put s'empêcher de jeter un regard vers le bas, plongeant entre mes seins nouvellement remontés.
Ah ouais.
Ma tête se jeta en avant, mon front fracassa son nez. Il me lâcha enfin et tituba en arrière. Immédiatement je lui envoyai une droite. Il s'écroula.
— Prends bien ça ! Criais-je en ajoutant un coup de pied dans les côtes de son corps à terre. Salopard ! Hu, c'est ma voix, ça ?
— Ja... Janine ?!
À l'autre bout de la salle, Édouard, un drôle de bâton sculpté à la main, était subjugué par ma transformation. Et ce visage non ridé, il l’avait connu, petit garçon.
— Oh, toi non plus je vais pas te rater ! Clamais-je en me dirigeant vers lui. Mais les flammes avaient atteint les deux fauteuils et me barraient le passage. Vérifiant que le monstre restait loin de moi - il se cachait dans d'autres hautes flammes aux alentours de Joël - je rasai le mur vers l'escalier pour pouvoir ensuite remonter vers lui.
Édouard m’ignora car il pensait que je voulais juste fuir. Il s'occupa du plus gros problème, et brandit son bâton devant lui. Il commença à déblatérer dans la langue bizarre.
Joël, qui avait entrepris de recommencer son étrange gestuelle, se tourna vers lui avec attention, ouvrit de grands yeux, et tressaillit. Comme pris de douleurs, il se recroquevilla sur lui-même. Trop heureux, le démon attaqua.
— Ah non, hein !
Courant comme jamais je n'avais couru, légère, dynamique, je fus sur Édouard en un instant, et pour me freiner, je plantais mon genou replié contre son dos. Il tomba en avant en criant, lâchant la baguette magique sous la douleur. Je levais la tête... Horreur.
La bête mordait Joël au bras. Le sang coulait à flot et il allait pour sûr le lui arracher dans quelques instants ! Les coups de poing de Joël sur sa tête étaient totalement sans effet.
Mais en plus, Marcu et Jacques étaient debout, et voyant que le démon avait enfin réussi à s'en prendre à lui, ils trottaient tout deux dans les passages moins enflammés pour venir vers moi et me régler mon compte !
Il n'y avait pas un instant à perdre. Comme eux aussi faisaient un grand tour à l'instar de moi tout à l'heure, je courus droit devant, au milieu de l'incendie, droit sur Joël. Si Marcu pouvait le faire, je pouvais...
La douleur était immédiate et non-négociable. Chaque pied approchant le sol, c'était deux ou trois langues brûlantes qui raclaient mes jambes donnant l'impression à mes nerfs d'être à vif ! Mais j'étais lancée, il fallait fuir en avant, encore plus vite. Je tenais le bâton magique que j'avais ramassé au passage, comme une batte de base-ball entre les mains d'un casseur. Une fois proche, je donnais un grand coup sur le flanc de la bête !!
Ça n'eut aucun effet autre que moi lâchant mon arme, incapable d'encaisser le choc que faisait ce coup contre un corps semblant fait en béton armé. Mais vif comme l'éclair, Joël l'attrapa. Le bâton brilla dans ses mains. Il posa, sans même frapper, l'extrémité sur le museau du chien géant. L'animal ferma les yeux, couina, et se retira en hâte.
Joël me passa le bâton, qui resta lumineux. Il remit ses mains sur ses hanches. Je compris, il avait besoin de temps. Il fallait que je fasse ma part, même si je devais sautiller sur place pour ne pas mourir brûlée par les pieds. La chaleur était pourtant très forte et mes jambes semblaient devenir des saucisses. Mais je devais tenir bon. Alors que je tenais la bête à distance en pointant le bâton vers elle, je me répétais dans ma tête : tu es jeune et forte, ceci n'est rien.
Joël releva dans une lenteur relative ses deux bras, les écartant de son corps. Les yeux fermés et la tête haute, c'est quand il eut les bras entièrement horizontaux qu'il sembla s'entourer d’une lumière blanche surnaturelle. À ses pieds, les flammes s'écartèrent. Je me jetai près de lui pour profiter de ce havre de paix.
Arrivée derrière ses épaules, je vis malgré moi son dos nu, et ce qu'il avait, en fait, très consciemment caché à nos yeux en sortant de la salle de bain...
Sur chacune de ses omoplates, une longue cicatrice verticale.
La lumière s'intensifia. Et Joël chanta.
C'était une voix de femme. De cantatrice. Une voix puissante, un chœur, un opéra.
Je serais incapable de retranscrire le moindre mot de ce qu'il avait prononcé.
C'était court mais merveilleux. Et les trois hommes, Édouard s'étant relevé, s'étaient arrêtés nets dans leur déplacement, subjugués comme moi par cette incantation divine venant de mon vagabond muet.
Et le chien démoniaque... cible directe de la formule magique, la pauvre bête m'apparaissait maintenant comme une cabot mouillé honteux. Couinant, il baissa la tête, se rétrécit sur lui-même, devint tout petit, puis disparut. Je savais sans savoir pourquoi qu'il n'était pas retourné dans son plan démoniaque, mais qu'il avait bel et bien été effacé. Comme pour me donner raison, le grimoire sur la table, déjà noirci par les flammes, se dissout également.
Flammes qui avaient entièrement disparues. Il ne restait que de nouvelles traces de suie, plus étendues.
Nos trois kidnappeurs, hagards, se demandaient quoi faire. Je m'accrochai alors à Joël comme une jeune fille en détresse dans les bras de Rambo. Ils ne pouvaient rien contre lui, sûrement.
Mais Marcu se tordit de douleur. Il planta une main crispée sur son ventre, et sans mot dire, tomba face contre terre.
Jacques tomba à genoux, soudainement à bout de forces. Et en accéléré, il devint ridé, maigre, émacié, puis livide, et tomba à son tour.
Terrifiée, je me tournai vers Édouard. Lui qui n'avait ni cancer ni dépassé son espérance de vie, allait-il...?
Édouard regardait ses mains couvertes de sang.
— Non, cette bless... elle avait guéri !
Il tomba aussi, crachant du sang.
— J'étais... immortel...
Tu étais immortel, mais seulement temporairement, Édouard...
Je pris Joël dans mes bras. Il me rendit l'accolade. Très vite, mes pieds ne sentirent plus la douleur des brûlures. Mais je sentais aussi ma peau devenir plus sèche et plus tirée, mon dos rétrécir et ma vue baisser. J'étais redevenue moi.
— Alors comme ça, on parle, finalement ?
C'était ma bonne vieille voix.
Joël me fit un sourire, et un non de la tête.
— Je vois. On chante, uniquement.
Il me fit oui de la tête, et m'invita à prendre les escaliers pour quitter ce lieu maudit.
Arrivée dans la cuisine, je sursautai en trouvant quelqu’un assis sur une chaise. Et je vis que c’était la servante, elle aussi toute vieillie, inconsciente, ou plutôt décédée.
Joël m’en détourna et m’aida à m’allonger sur le canapé. Il avait raison, j’étais éreintée. Et je m’endormis presque immédiatement.
Je suis sûre de ne m’être réveillée que peu de temps après. Pourtant le calme était pesant dans cette maison vide. Il n’y avait plus de corps dans la cuisine ni de sang dans le patio. La cave était presque vide, les coffres forts enlevés, les corps disparus. Ne restaient que un ou deux meubles vides et du noir partout. En parcourant la maison et en l'appelant, je sentais la colère monter. Il m’avait endormie pour disparaître, le salaud !
Par la fenêtre, une grosse masse bougea. Je l’ouvris en hâte.
Joël déplaçait à bout de bras la table sculptée de la cave comme si elle était en carton.
Il la déposa sur un tas au milieu du gravier où se trouvaient les autres meubles disparus, et sûrement, hum... des gens. Je fis le tour et traversai le jardin. Le temps que je m’approche, Joël avait de nouveau pris sa position de Jésus sur la croix.
Et il ne chanta qu’un seul mot.
Sans l’écho de la cave, la musique s’envola dans l’air. Et le tas trembla, devint blanc, puis disparut sans laisser de traces.
Devant nous se trouvait le gravier, et derrière, les arbres, natures, calmes, comme si rien de tout ça n’était arrivé. Je pris le bras de Joël pour le tirer vers la maison.
— Tu as assez travaillé, à ton tour de te reposer. Je vais nous préparer quelque chose.
La maison de ma jeunesse était de retour. Ses modifications étaient minimes, en fait. J’y retrouvais maints détails que je connaissais. Je me retrouvais dans ma cuisine comme si elle n’avait jamais changé. Tout était déplacé, toute la vaisselle remplacée, mais ils étaient dans mes meubles, et j'allumais mes plaques... Oui, j’étais de retour chez moi, cette fois.
Il dévora avec appétit ma tarte aux pommes. Nous fîmes chacun un tour dans une salle de bain. J’appelai mes enfants qui étaient étonnés comme jamais d’apprendre que j’avais récupéré la maison... sans aucune difficulté. Et qu’elle était déjà disponible pour les prochaines vacances. Encore une victoire de maman !
Puis dans l’après-midi, après le café, Joël se leva d’un air décidé, et prit les escaliers. Il revint dans le salon avec son grand sac, bien rempli.
— Tu vas reprendre le train ?
Il fit oui.
— Ce serait plus simple en volant, non ?
Il haussa les épaules.
— Et tu vas faire le tour de chaque village, parcourir chaque rue existante, raser chaque maison, pour en déceler les traces démoniaques et les exorciser ?
Il prit un peu de temps pour répondre. Puis il fit oui, tout simplement.
— Je t’emmène à la gare. Dis-je en secouant les clefs que j'avais trouvé. Je crois qu’il y a une décapotable dans le garage qui nous attend.
Le retour ne prit qu’un instant. Et il allait falloir que je me débarrasse discrètement de ces trois voitures de luxe. Elles avaient été payées en monnaie criminelle, pas en sacrifices, du coup elles n’avaient pas disparu. Bah, j’avais le temps. Sur la place et le quai de la gare, il y avait un peu plus de monde que la veille. J’étais rassurée en voyant cette petite agitation quotidienne, de constater que le village vivait encore un peu.
— Dis mon petit Joël, tu peux pas me faire redevenir jeune fille quelques heures de plus ? Juste le temps que je fasse un tour...
Les yeux pétillants, il s’élança dans un grand rire silencieux, puis me prit dans ses bras. Il monta dans le train, et disparut à jamais.
Le jardin avait besoin de quelques coupes. Le salon principal devait être re-ordonné. La télé descendue à la cave. Il y avait de quoi faire. En quelques semaines, ma maison de vacances idéale avait pris forme, et ma progéniture put m'y rejoindre et y passer du temps.
Nous n’eûmes jamais de visite impromptue de quelque mafia avec un corps dans un coffre. Heureusement ! J’imagine que ce service était aussi connu par une formule magique, et qu’il avait disparu comme le reste.
Quelque mois plus tard, les roses avaient éclos sur la tonnelle. Ça ne recouvrait pas encore grand-chose, mais c’était un début. C’est la réflexion que j’exposai à ma fille en prenant le petit déjeuner dehors. Douce quiétude en famille. N’était-ce pas ce qui compte vraiment ?
— Nan, c’est nul, y’a pas la télé ! Répondit le petit dernier, qui s’enfuit en courant, rouge de rage.
— C’est l’argument principal, dit ma fille, en étendant les bras, respirant un grand bol d’air à la rose.
Merci à tous d’avoir lu cette histoire. J’espère qu’elle vous a plu. Je ne vous demande pas d’y croire, je n’ai aucune preuve.
Mais l’explication officielle, d’un accident de chaudière dans la cave pour expliquer toute cette suie, est trop banale pour moi. Tout comme la disparition des anciens habitants, non résolue. Ah, disait le vieux commissaire, la plupart des disparitions restent irrésolues. Mais moi, du haut de mes huit ans, je le voyais bien, son air satisfait et revanchard sur son visage, lui qui clairement les avait toujours suspectés, mais n’avait jamais rien pu prouver.
Les histoires de mamie variaient avec l’âge, devenant de plus en plus incohérentes, certes. Mais entre celle où le GIGN débarque, celle où il y avait douze kilos de coke dans la cave, celle où une secte de cinquante personnes occupait la maison, celle où le vagabond était la première victime et qu’elle avait réussi à s’en sortir in extremis en mettant le feu à la cave... Il fallait bien en choisir une. Je pense avoir retranscrit la version à laquelle mamie tenait le plus.
Me concernant, je compte bien croiser un jour l’ange Joël rasant un mur à la recherche de forces obscures, ou aidant une vieille personne à traverser la rue. Oh, les divinités, je n'y crois pas plus que vous. Je pense juste que lui est là, et qu’inlassablement, il continue sa mission protectrice.
J'espère que cette histoire vous a plu!
N'hésitez pas à la commenter sur l'un de ces sites, me donner votre avis, la partager à d'autres lecteurs intéressés. Ça me ferait très plaisir!